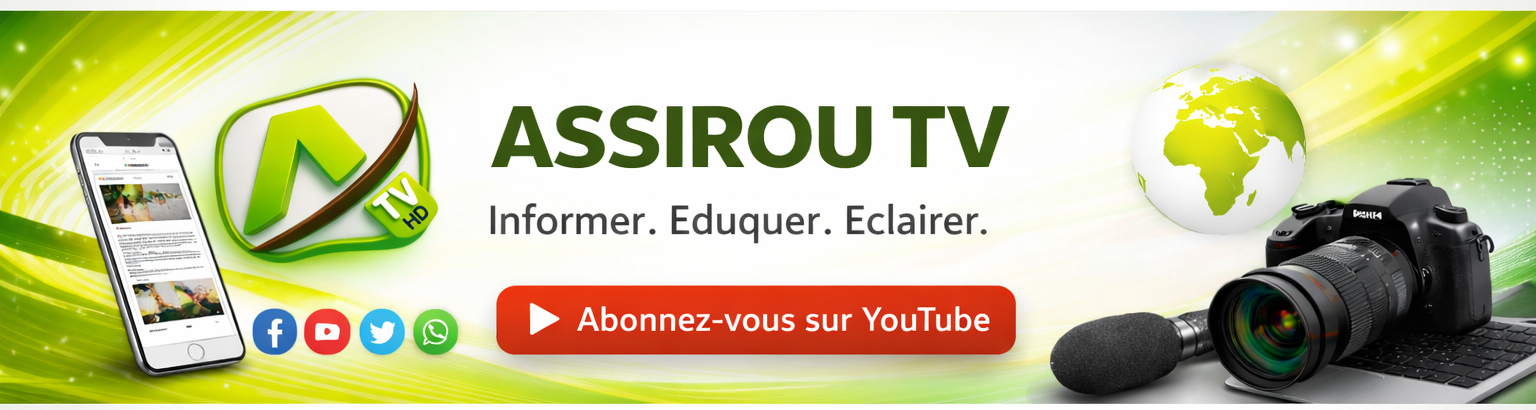Par Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), ancien ministre de l’Économie et du Plan.
L’intégration africaine est une ambition stratégique, mais sa réussite repose sur bien plus que la construction d’infrastructures physiques. Elle nécessite aussi une modernisation profonde des processus économiques et institutionnels, un « logiciel » plus efficace pour accompagner la libre circulation des biens et des personnes sur le continent.
Selon la Banque mondiale, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait devenir la plus grande du monde, avec 1,4 milliard d’habitants et un PIB de 3 400 milliards de dollars. La BAD estime que cette initiative pourrait doubler le commerce intra-africain en une décennie. Pourtant, le commerce entre pays africains ne représente que 15 % de leurs échanges, loin derrière l’Asie (60 %) et l’Europe (65 %). Malgré les avancées réalisées, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour concrétiser cette vision.
Infrastructures : l’urgence d’un investissement massif
L’intégration africaine peut être comparée à la construction d’un système informatique avancé : sans matériel performant, le « hardware », le système ne peut fonctionner. Aujourd’hui, le continent accuse un déficit de financement des infrastructures estimé entre 130 et 170 milliards de dollars par an, touchant notamment les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.
Historiquement, les investissements internationaux ont joué un rôle clé, mais l’Afrique doit désormais prendre en main son développement en mobilisant ses propres ressources. Les fonds souverains, fonds de pension et investissements privés africains doivent être mis à contribution, soutenus par des institutions financières comme la BAD, qui peut utiliser son expertise et sa notation de crédit pour attirer ces capitaux.
Des initiatives telles que l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA), portée par la BAD et Africa50, illustrent cette approche en mobilisant 10 milliards de dollars pour financer des projets écologiques. De même, la Mission 300, récemment lancée en Tanzanie, met l’accent sur l’intégration régionale du secteur énergétique.
Le commerce africain : une digitalisation indispensable
L’intégration ne se résume pas aux infrastructures physiques. Un changement de paradigme est nécessaire dans la gestion administrative et commerciale. Aujourd’hui, des procédures bureaucratiques dépassées freinent le développement du commerce intra-africain, malgré l’existence d’infrastructures.
L’innovation technologique constitue une réponse clé. Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) promet d’économiser 5 milliards de dollars par an en simplifiant les paiements transfrontaliers. Des tests menés en Afrique de l’Est ont également démontré que l’utilisation de la blockchain pour digitaliser les chaînes de valeur pourrait réduire les coûts commerciaux de 20 %, lutter contre la fraude et faciliter l’accès aux marchés internationaux.
À l’approche du sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba, il est essentiel d’accélérer la mise en œuvre du protocole sur le commerce numérique de la ZLECAf. Une approche intégrée combinant infrastructures physiques et modernisation numérique est la clé pour transformer l’Afrique d’un simple exportateur de matières premières en une véritable puissance industrielle et agricole.
Vers une Afrique plus compétitive et dynamique
L’intégration africaine ne se limite pas à la libre circulation des marchandises. Elle passe également par l’amélioration des services essentiels comme la finance, les transports, l’éducation et la santé. En renforçant ces secteurs, l’Afrique pourra mieux s’insérer dans les chaînes de valeur mondiales et créer des opportunités économiques pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes.
Avec une population qui devrait doubler d’ici 2050, l’urgence est évidente. L’Afrique doit mobiliser ses propres ressources, moderniser ses infrastructures et adopter des solutions technologiques innovantes pour concrétiser son potentiel. Le moment est venu de passer d’une « zone de libre-échange en devenir » à une puissance économique dynamique et innovante.